Après deux ans d’attente, Le fascisme islamique sort enfin en France. Le politologue germano-égyptien y revient sur les vraies origines de l’islam politique et dresse un parallèle entre le fascisme et l’islamisme.
Le fascisme islamique a failli ne pas être publié en France. Initialement achetés par Piranha, les droits d’auteur ont finalement été cédés à Grasset. Le premier en a reporté la publication après chacun des attentats survenus en France entre 2014 et 2016, jusqu’à se désister après celui de Nice. “Dans un email, il m’a expliqué qu’il était incapable de protéger ses employés, que mon livre allait attiser la haine contre les musulmans et être instrumentalisé par l’extrême droite. S’il s’était contenté de me dire qu’il avait peur, je l’aurais compris. Mais là, il a pris sa lâcheté pour une vertu”, raconte l’auteur. Qu’est-ce qui rend ce livre potentiellement dangereux ? On connaissait les liens entre Amin Al Husseini et Adolf Hitler. L’ancien mufti de Jérusalem avait même recruté des musulmans bosniaques pour le compte des divisions SS. Ce que nous apprend Hamed Abdel-Samad, c’est que le fondateur des Frères musulmans, Hassan El Banna, entretenait des relations suivies avec Al Husseini au moins à partir de 1927, soit un an avant la création de la confrérie, qui n’aurait d’ailleurs pas existé sans la bénédiction du mufti. Le penseur germano-égyptien y trace également les similitudes entre l’islam politique — “ou l’islam tout court”, comme il aime à le rappeler — et l’idéologie fasciste, ainsi que les liens entre la confrérie et le nazisme. Fils d’imam et lui-même ancien membre des Frères musulmans dans sa jeunesse, Hamed Abdel-Samad est devenu, en Allemagne, une figure médiatique de la critique de l’islam, ce qui lui a valu plusieurs fatwas et menaces de mort, au point d’être contraint de vivre sous protection policière. Dans le monde arabe, il est surtout connu pour sa chaîne YouTube, Hamed TV, et sa série de vidéos “Box of Islam” dont la dernière en date est titrée “L’islam n’a pas besoin d’un Martin Luther, mais d’une Coco Chanel”.
Telquel: Qu’est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre ?
Hamed Abdel-Samad: Puisque je vis en Allemagne depuis 20 ans, j’ai étudié l’histoire de l’Allemagne et celle du nazisme. Avant Le fascisme islamique, j’ai écrit des livres sur l’islam politique, et pendant mes recherches, j’ai noté que les auteurs occidentaux qui ont écrit sur la question s’accordent à dire qu’il s’agit là d’un phénomène nouveau qui est venu comme réaction au colonialisme. J’ai refusé cette simplification et décidé d’écrire un livre où je démontre les racines idéologiques de l’islam politique. J’étais parti avec cette idée-là, avant que d’autres repères commencent à se dessiner. J’ai remarqué alors des similitudes à la fois étranges et prononcées entre l’islam politique et le fascisme tel qu’il s’est développé en Allemagne et en Italie durant la première moitié du siècle dernier.
Sur quels points a porté votre comparaison de l’islam politique avec le fascisme et le nazisme ?
D’abord dans l’idéologie elle-même. Ils partagent une vision manichéenne du monde : le bien contre le mal, et les croyants contre les mécréants. L’islam place les musulmans au-dessus du reste de l’humanité, car ils sont “la meilleure communauté qu’on ait fait surgir pour les hommes” (Al Imran, 110) et le nazisme a fait de même avec la race aryenne. Dans le Coran, “Al Mouchrikoun (les associateurs) ne sont qu’impuretés” (Attawba, 28), “Ils ne sont en vérité comparables qu’à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier” (Al furqan, 44). Les nazis appelaient les juifs “untermenschen”, ou sous-hommes, et les comparaient à des insectes et des vermines. Il y a en commun un mépris pour l’ennemi au point de le déshumaniser, et c’est la première étape de la justification de son extermination. Ces idéologies voient en la guerre une ordonnance sacrée. Pour les fascistes, la mort sur le champ de bataille est un honneur, et l’islam voit le jihad comme une fin en soi. Dans le Coran, “Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. Ils combattent dans le sentier d’Allah : ils tuent et ils se font tuer” (Attawba 111), et dans un hadith authentifié, Mohammed a dit : “Quiconque meurt sans avoir combattu et sans en avoir jamais eu le désir meurt en ayant l’un des traits caractéristiques de l’hypocrisie” (1341, Mouslim).
Ensuite, ils se ressemblent dans la structure. L’idée des milices comme moyen de protéger l’idéologie et effrayer les ennemis — “Et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d’effrayer l’ennemi d’Allah et le vôtre”, (Al Anfal, 60) —, et le principe du guide suprême, un chef inspirant, infaillible, incritiquable et sacré, un Führer ou un Duce, que les musulmans ont en la personne du Prophète.
Enfin, ils partagent les mêmes buts : la domination mondiale et la rééducation de la société, car pour eux cette entité est perverse. L’islam et le fascisme ne font pas de différence entre l’individu et la société, ils se mêlent des détails les plus précis de la famille nucléaire et veulent la ramener à son état pré-moderne, avec l’homme comme chef de famille et une distribution traditionnelle des rôles entre les deux sexes.
Dans votre livre, vous soutenez que Hassan El Banna s’est largement inspiré d’Adolf Hitler dans sa conception de la confrérie des Frères musulmans. En quoi se manifeste cette influence ?
Par exemple, après la création de leur confrérie en 1928, les Frères musulmans ont constitué des milices calquées sur les modèles nazi et fasciste, et il y avait des similitudes non seulement dans l’idéologie, mais aussi dans l’organisation. Les scouts de Hassan El Banna, — qu’il appelait les “Jawala”— ont été inspirés par les jeunesses hitlérienne et mussolinienne, si bien que ses membres portaient eux aussi des blouses brunes et noires. Hitler parlait de “Weltherrschaft”(domination du monde), et El Banna de “Oustadiyat al âalam” (le professorat du monde). Ali Âachmaoui, ex-chef des renseignements secrets des Frères, a écrit dans ses mémoires (L’histoire secrète des Frères musulmans, publié en 2006, ndlr) que cet organe a été inspiré à El Banna par la Gestapo.
Est-il vrai que Hitler s’était converti à l’islam et a adopté le nom de Hadj Mohammad Hitler ?
Les Frères musulmans jouaient sur tous les fronts. Tantôt ils le faisaient avec les Britanniques, tantôt avec les Allemands. Ils ont fait la propagande d’Hitler en Égypte en répandant la rumeur sur sa conversion à l’islam. Ils ont aussi dit qu’il a effectué son pèlerinage à La Mecque en secret, qu’il s’appelait désormais Hadj Mohammad Hitler et que, quand il prendra Le Caire, il épargnera les mosquées puisqu’il est un musulman, et donc un unificateur, et son but est de mettre fin à l’occupation britannique. Et mon livre comporte les références qui prouvent la coopération directe entre les Frères et les nazis.
Vous dites aussi qu’il y avait un but commun entre les Frères musulmans et les nazis consistant à affaiblir la présence britannique en Afrique du Nord. Quel était leur vrai projet dans la région ?
Les Frères musulmans voulaient s’étendre, et pour ce faire, ils étaient prêts à collaborer avec le diable lui-même. Et, malheureusement, ils ont réussi. Si le PJD existe au Maroc et Ennahda en Tunisie, c’est parce qu’ils sont les produits de ce vieux projet d’expansion.
Aujourd’hui, comment les Frères musulmans voient-ils leur relation avec le nazisme ?
Ils ont changé de couleur. À l’apogée du fascisme et du nazisme, Hassan El Banna couvrait d’éloges Hitler et Mussolini et admirait leur manière de mener leurs peuples vers la victoire et la grandeur. Mais à partir de 1948, il s’est mis à qualifier les deux mouvements d’échecs, et à répéter que la solution ultime était l’islam. Lors d’une conférence en Allemagne, une personne du public a demandé à Tariq Ramadan s’il était vrai que son grand-père était l’ami d’Amin Al Husseini et un grand admirateur d’Hitler, il a nié tout en bloc. Il se trouve qu’une photo datant de 1927 sur laquelle Hassan El Banna et Amin Al Husseini posaient ensemble figurait dans les archives du site des Frères ikhwanonline.info. Au lendemain de cette conférence, cette photo a été supprimée. Amin Al Husseini a une très mauvaise réputation en Europe, c’est un criminel de guerre qui a échappé à la punition en se réfugiant en Égypte.
Que pensez-vous de Tariq Ramadan ?
Tariq Ramadan essaie de moderniser l’idéologie de la confrérie en disant qu’elle n’est pas incompatible avec la démocratie. Mais ce système a été vivement critiqué par El Banna dans Rissalat Annour (La lettre de la lumière), où il a exhorté le roi Farouk à dissoudre tous les partis politiques de peur qu’ils n’attisent la fitna dans la nation. Il lui a dit qu’il ne devait rester qu’un seul parti, celui de l’islam et d’Allah. L’idée du parti unique est un autre point commun avec le fascisme. Les Frères refusaient catégoriquement la démocratie, jusqu’à ce qu’ils découvrent que le seul moyen d’accéder au pouvoir était à travers les urnes.
Comment jugez-vous la manière avec laquelle l’Occident gère le radicalisme islamique ?
C’est un mélange d’intérêt, de peur et de naïveté. L’intérêt politique et économique entre l’Occident d’un côté, et les pays du Golfe, la Turquie et l’Afrique du Nord de l’autre. La peur du terrorisme et la crainte que les musulmans qui vivent déjà dans ces sociétés occidentales ne servent de cheval de Troie à des dirigeants islamistes comme Recep Erdogan. À titre d’exemple, face au refus des Pays-Bas de permettre à l’AKP de mener sa campagne électorale sur son sol, un membre du parti islamiste turc avait déclaré que “les Pays-Bas ne comptent que 48 000 soldats, mais il y a 400 000 Turcs sur place. Nous pouvons facilement envahir le pays pour peu que nous le décidions”. La gauche occidentale est devenue extrêmement naïve, elle considère ces islamistes comme des opprimés, et croit en leur discours de victimisation. Ces gens-là attaquent mes écrits plus que les musulmans eux-mêmes, ils me traitent de raciste alors que je critique les idées, pas les groupes ethniques. D’ailleurs, les musulmans ne sont pas un groupe ethnique homogène.
À chaque caricature ou critique, les musulmans dans le monde réagissent de manière violente. Quelle est l’origine de cette hypersensibilité ?
Il y a un énorme décalage entre notre identité fantasmée et notre réalité objective, entre notre passé et notre présent. Nos livres d’histoire nous font croire que tous les musulmans sont des Saladin, des Qutuz et des Tariq Ibn Ziad. Des chevaliers vaillants — mashallah — capables de conquérir l’Andalousie et l’Afrique du Nord, et qui ne sont que virilité, jeunesse et fierté. La vérité actuelle c’est la pauvreté, le déni, l’ignorance et la frustration sexuelle. Nous n’arrivons pas à accepter notre nouveau rôle. Allah a dit que nous sommes “la meilleure communauté qu’on ait fait surgir pour les hommes”, alors comment osent-ils se comporter avec nous de la sorte ? D’autant que le Coran et le Hadith ont implanté dans nos têtes cette idée du mécréant sale qui veut éteindre la lumière de Dieu.
Croyez-vous en la possibilité d’une réforme de l’islam ?
S’il était possible de réformer l’islam, on l’aurait fait il y a des siècles. L’islam est une entité ultra-sacralisée, qui oserait réformer la parole d’Allah ? De plus, il n’y a pas d’autorité centrale responsable de l’islam, comme c’est le cas pour les Églises catholique et orthodoxe. La religion est devenue notre unique source identitaire, et il y a une forte volonté de la préserver. L’islam est fondamentalement incompatible avec la laïcité, car c’est un héritage qui mélange la religion avec l’économie, la politique et le militarisme, et il complique les relations avec quiconque n’est pas musulman. Et, personnellement, je ne crois pas en la salvation collective. Ce que nous pouvons réformer en revanche, c’est la pensée individuelle. Si nous considérons l’islam comme un supermarché, nous ne pourrons pas améliorer l’endroit ou ses marchandises, mais nous pouvons améliorer le comportement du consommateur de sorte qu’il ne choisisse pas les produits périmés.







/http%3A%2F%2Fpippa.fr%2Fclient%2Fcache%2Fproduit%2F300_____Les%20Refus%20de%20Grigori%20Perelman_248.jpg)
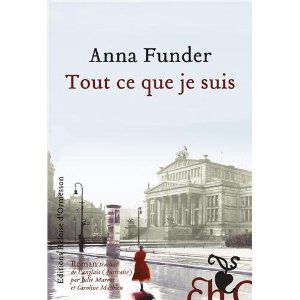 Pour ceux qui croient en la littérature, la découverte d’un grand roman est comme une rencontre amoureuse : on s’attache au livre jusque dans ses moindres détails et on se souvient
avec émotion des instants passés en sa compagnie… Rares sont évidemment les livres qui nous font passer de tels moments, car la production littéraire contemporaine est marquée par l’inflation et
la médiocrité, en France comme ailleurs. « Tout ce que je suis », d’Anna Funder, est un de ces livres qui vous marquent et vous transforment.
Pour ceux qui croient en la littérature, la découverte d’un grand roman est comme une rencontre amoureuse : on s’attache au livre jusque dans ses moindres détails et on se souvient
avec émotion des instants passés en sa compagnie… Rares sont évidemment les livres qui nous font passer de tels moments, car la production littéraire contemporaine est marquée par l’inflation et
la médiocrité, en France comme ailleurs. « Tout ce que je suis », d’Anna Funder, est un de ces livres qui vous marquent et vous transforment.
 Bien plus qu’un témoignage sur
une époque mouvementée, il s’agit donc d’une authentique œuvre romanesque dans laquelle l’histoire sert de toile de fond, et où la véracité des personnages est indépendante de leur vérité
historique. Anna Funder a pourtant entrepris des recherches approfondies pour écrire son livre, mais elle parvient à s’émanciper de la trame historique pour donner à son œuvre un souffle
romanesque qui emporte le lecteur.
Bien plus qu’un témoignage sur
une époque mouvementée, il s’agit donc d’une authentique œuvre romanesque dans laquelle l’histoire sert de toile de fond, et où la véracité des personnages est indépendante de leur vérité
historique. Anna Funder a pourtant entrepris des recherches approfondies pour écrire son livre, mais elle parvient à s’émanciper de la trame historique pour donner à son œuvre un souffle
romanesque qui emporte le lecteur.


 David Shahar (1926-1997) est sans doute le seul écrivain israélien dont une rue de France porte le nom : la rue David Shahar se trouve à Dinard, en Ile-et-Vilaine. Ceux qui ont eu la chance de croiser l’écrivain, en France ou en Israël, se souviennent de sa casquette de marin, éternellement vissée sur son crâne… Il ne s’agissait pas d’un simple accoutrement mais de la marque de son attachement profond pour la Bretagne, qui transparaît dans son œuvre à plusieurs endroits.
David Shahar (1926-1997) est sans doute le seul écrivain israélien dont une rue de France porte le nom : la rue David Shahar se trouve à Dinard, en Ile-et-Vilaine. Ceux qui ont eu la chance de croiser l’écrivain, en France ou en Israël, se souviennent de sa casquette de marin, éternellement vissée sur son crâne… Il ne s’agissait pas d’un simple accoutrement mais de la marque de son attachement profond pour la Bretagne, qui transparaît dans son œuvre à plusieurs endroits. Shahar a non seulement passé de longues périodes en France – et notamment en Bretagne où habitait son amie et traductrice, Madeleine Neige – mais il est aussi devenu, grâce à cette dernière, un auteur reconnu en France, où son œuvre publiée chez Gallimard jouit d’une notoriété presque plus grande qu’en Israël. Il rapporte à ce sujet cette anecdote : un écrivain français en visite en Israël fit un jour la réponse suivante à un journaliste, qui lui demandait s’il avait lu des auteurs israéliens :
Shahar a non seulement passé de longues périodes en France – et notamment en Bretagne où habitait son amie et traductrice, Madeleine Neige – mais il est aussi devenu, grâce à cette dernière, un auteur reconnu en France, où son œuvre publiée chez Gallimard jouit d’une notoriété presque plus grande qu’en Israël. Il rapporte à ce sujet cette anecdote : un écrivain français en visite en Israël fit un jour la réponse suivante à un journaliste, qui lui demandait s’il avait lu des auteurs israéliens :
 Car en réalité, si Shahar a pu être justement comparé à Proust, il n’a pas cherché délibérément à imiter celui-ci, qu’il a découvert sur le tard. (Il semble que la première à avoir fait ce rapprochement soit Jacqueline Piatier dans son article
Car en réalité, si Shahar a pu être justement comparé à Proust, il n’a pas cherché délibérément à imiter celui-ci, qu’il a découvert sur le tard. (Il semble que la première à avoir fait ce rapprochement soit Jacqueline Piatier dans son article 